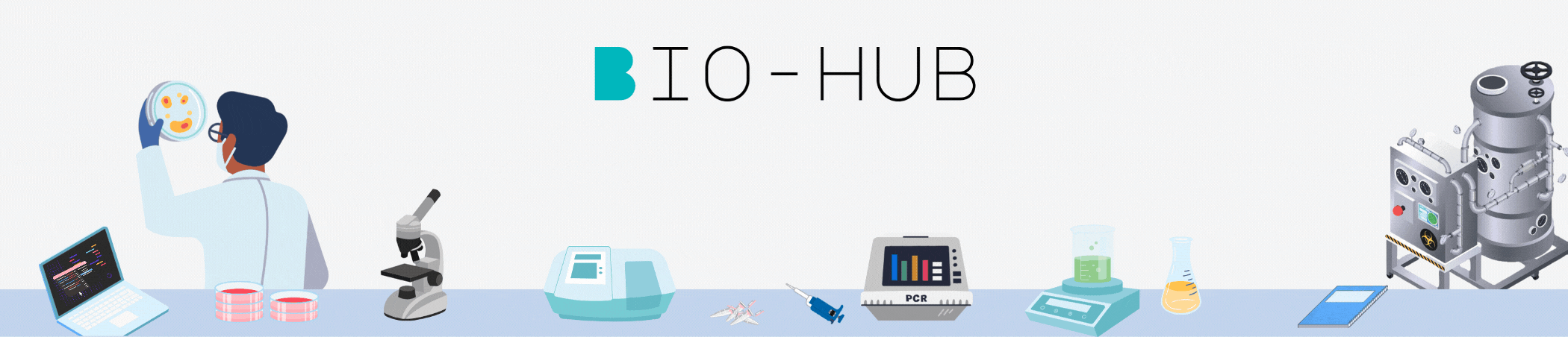Avec « The Experts Corner », MabDesign vous propose une plongée au cœur de l’innovation en biothérapies. À travers des entretiens exclusifs avec des experts du secteur, découvrez leur vision du marché, leurs analyses des défis actuels et leurs perspectives sur les dernières avancées. Des conversations inspirantes pour mieux comprendre le présent et l’avenir de la bioproduction et des biomédicaments.

Thérapies géniques
Samuel Salot
Directeur des Opérations, EG427
Les technologies deviennent de plus en plus sophistiquées, mais aussi plus ciblées, plus modulables. C’est un peu comme les anticorps dans les années 90 : on entre dans une phase de maturation accélérée.

EG 427 est une biotech française fondée en 2019, avec une approche de thérapie ADN que nous qualifions de ciblée. Contrairement à d’autres approches systémiques, notre technologie repose sur un vecteur herpétique non réplicatif qui permet un ciblage extrêmement précis de certains neurones. Une fois à l’intérieur, on peut faire exprimer des transgènes de manière stable, sélective et prolongée — ce qui ouvre la voie à des effets thérapeutiques durables.
Nos premiers développements portent sur des indications liées au système nerveux périphérique, mais la plateforme a un potentiel bien plus large, notamment, grâce à sa capacité à intégrer des transgènes de grande taille et à bénéficier de la latence naturelle du HSV. Cela permet une régulation fine de l’expression des transgènes thérapeutiques, y compris pour des applications complexes.
Aujourd’hui, nous avons un programme clinique actif : en juin 2024, la FDA nous a autorisés à lancer un essai dans la vessie neurologique, une pathologie fréquente et où persiste un fort besoin pour les patients, ce qui démontre à la fois la pertinence médicale et la maturité de notre technologie.
- Vous êtes aujourd’hui COO d’EG 427. Pouvez-vous nous raconter votre parcours avant de rejoindre la société, et nous expliquer votre rôle actuel ?
J’ai démarré ma carrière chez Innate Pharma, où j’ai été formé aux bases du développement de biomédicaments. Mon tout premier projet était en thérapie cellulaire, ce qui m’a conduit très tôt à explorer les thématiques de transfert génique et d’immunothérapie. J’ai ensuite cofondé une société de services spécialisée en immuno-monitoring, spin-off d’Innate, avant de me lancer dans le conseil stratégique auprès de biotech françaises. J’y ai accompagné des projets de CAR-T, d’anticorps monoclonaux et dérivés ou encore de vaccins thérapeutiques, souvent en lien avec des enjeux de développement ou de structuration d’entreprise.
C’est à cette période que j’ai rencontré Philippe Chambon, le CEO d’EG 427. Il revenait des États-Unis avec l’ambition de développer cette technologie virale innovante. Il m’a proposé de l’accompagner dans la structuration de l’entreprise en partant de zéro. Nous avons monté l’infrastructure, recruté les premières équipes, posé les bases du plan de développement, et surtout travaillé sur le process de bioproduction.
Mon rôle a évolué avec la croissance de la société et je suis maintenant fortement impliqué sur les aspects stratégiques, industriels et réglementaires, notamment autour de notre actif principal, EG110A.
- Vous avez mentionné avoir évolué très tôt dans le domaine des thérapies géniques. Comment avez-vous vu ce champ évoluer, notamment en termes d’avancées technologiques majeures ?
« Puis, l’arrivée des CAR-T, portée par des figures comme Carl June ou Michel Sadelain, a marqué un changement de paradigme. « .
La thérapie cellulaire, quand j’ai débuté, était encore expérimentale. Il y avait de fortes attentes mais aussi des limites : manque de standardisation, coûts élevés, reproductibilité limitée. Puis, l’arrivée des CAR-T, portée par des figures comme Carl June ou Michel Sadelain, a marqué un changement de paradigme. Le lancement de Kymriah a été un signal fort pour l’industrie.
En parallèle, on a vu émerger des résultats concrets du côté de la thérapie génique “pure”, avec des vecteurs comme les AAV, notamment dans des maladies rares comme la myopathie de Duchenne. Mais le domaine reste cyclique. Avant le COVID, on parlait de 25 milliards de dollars d’investissement annuel, avant de voir une chute brutale post-crise.
Cela dit, l’innovation ne s’est jamais arrêtée. L’exemple récent du rachat de Capstan Therapeutics par AbbVie, pour développer des CAR-T in vivo en utilisant des vecteurs non-viraux, montre que des modèles plus simples, industrialisables, sont en train d’émerger.
- On observe aujourd’hui une forte maturité autour des anticorps monoclonaux, contrairement aux approches plus récentes comme les thérapies géniques ou cellulaires. Voyez-vous des différences fondamentales en termes de développabilité, de modèle économique, ou de trajectoire d’industrialisation ?
« Nous avons des procédés proches de ceux de la production vaccinale, éprouvés, simples à transférer industriellement.«
Oui, clairement. Les thérapies autologues sont cohérentes sur le plan scientifique, mais elles posent des problèmes sérieux de logistique, de standardisation et de remboursement. Leur industrialisation reste complexe. Les approches allogéniques, bien qu’attrayantes, sont encore confrontées à des verrous biologiques — compatibilité, rejet, expansion.
En revanche, les thérapies géniques vectorisées, comme les AAV, ont le potentiel de toucher des populations plus larges, mais à condition de réduire les coûts de fabrication et d’optimiser les process.
C’est là que notre approche avec l’HSV non réplicatif prend tout son sens. Nous avons des procédés proches de ceux de la production vaccinale, éprouvés, simples à transférer industriellement. Les quantités de vecteurs nécessaires par dose sont faibles, et donc les coûts de revient nettement inférieurs à ceux des AAV. Ce modèle nous permet d’envisager des applications plus accessibles, notamment pour les maladies chroniques à forte prévalence.
- Vous avez désormais franchi le cap de la clinique avec votre produit. Quels ont été, selon vous, les principaux défis translationnels pour passer de la phase préclinique à la phase I ?
« Le préclinique, c’est le moment où l’on pose les fondations — et elles doivent être solides. »
L’un des points clés a été d’intégrer le réglementaire dès le début. Dès 2021, nous avons structuré notre plan de développement en gardant en tête les attentes de la FDA, avec qui nous avons entamé très tôt un dialogue. Cela nous a permis de faire des gap analyses utiles, et d’ajuster nos priorités.
Sur le plan scientifique, la difficulté est de traduire une idée innovante en données précliniques robustes. Souvent, les outils n’existent pas encore : il faut concevoir ou adapter des analyses spécifiques, éviter les données non exploitables, rester concentré sur ce qui compte — efficacité et sécurité.
Ce travail nécessite une agilité permanente, car il y a chaque semaine de nouveaux obstacles à surmonter. Le préclinique, c’est le moment où l’on pose les fondations — et elles doivent être solides.
- Vous travaillez sur une thérapie innovante. Comment gérez-vous les relations avec les agences réglementaires ?
« On a toujours cherché à aller à l’essentiel : montrer l’efficacité, s’assurer de l’innocuité, comprendre le mécanisme d’action. »
On a fait le choix d’aller rapidement au contact des autorités, même à un stade où certains éléments n’étaient pas totalement figés. Aux États-Unis, les échanges avec la FDA ont été particulièrement constructifs. Ils nous ont permis d’affiner nos hypothèses et de bâtir un plan clair.
En parallèle, on a constitué un réseau d’experts de haut niveau, notamment en CMC, analytique, pharmacologie. Ce sont des personnes expérimentées qui nous accompagnent au quotidien, pas juste en mode ponctuel.
Cela nous a permis de prendre toutes les décisions de développement en gardant les exigences réglementaires à l’esprit, ce qui est, à mon avis, indispensable pour des projets innovants. On a toujours cherché à aller à l’essentiel : montrer l’efficacité, s’assurer de l’innocuité, comprendre le mécanisme d’action.
- Selon vous, quels sont les éléments essentiels d’un bon écosystème pour développer une thérapie génique innovante ?
« Le succès d’un programme, ce n’est pas juste une question de technologies. »
Il y a les collaborations internes, souvent sous-estimées, et les partenariats externes.
En interne, un alignement fort entre l’équipe dirigeante, les investisseurs et les opérationnels est critique pour assurer la réussite d’un projet d’innovation. Cela demande de la transparence, de l’écoute et un objectif partagé. Des tensions internes peuvent freiner un projet, même très innovant.
À l’extérieur, le facteur humain est déterminant. Travailler avec des prestataires compétents, mais surtout engagés, est clé. Un bon exemple est notre collaboration avec notre CDMO italienne. Nous avons été très présents sur site, car on voulait comprendre les problématiques et avancer ensemble. Il faut assumer la responsabilité partagée, même quand ça bloque. Le succès d’un programme, ce n’est pas juste une question de technologies. C’est aussi une question de relations humaines, de confiance et d’engagement mutuel.
- Vous êtes basés à Cochin, avec une présence aux Etats-Unis. Quel est, selon vous, le rôle de l’écosystème local dans le développement de votre thérapie génique ?
« On a toujours eu une vision globale : on va chercher l’expertise là où elle est, que ce soit à Paris, aux Etats-Unis, ou ailleurs en Europe ».
On a toujours eu une vision globale : on va chercher l’expertise là où elle est, que ce soit à Paris, aux Etats-Unis, ou ailleurs en Europe. L’écosystème local est important s’il nous apporte quelque chose, mais on ne s’y limite pas.
Nous avons été confrontés à une contrainte réglementaire spécifique à la France — la réglementation MOT, MicroOrganismes et Toxines — qui contraint fortement certaines manipulations en lien avec notre transgène, bien que celui-ci ne soit qu’un fragment non toxique des toxines botuliques. Ces contraintes, unique en France, nous ont poussés à externaliser certaines opérations à l’étranger, dont nos activités de production en Italie et en Allemagne.
Ce n’était pas un choix de confort : c’était une nécessité réglementaire. Cela illustre aussi la difficulté de développer certaines innovations dans un cadre local rigide. D’où l’importance de rester pragmatique et agile dans nos choix de partenaires et de sites.
Comment percevez-vous l’évolution du paysage concurrentiel dans le domaine des thérapies géniques ?
« Le rachat de Capstan par AbbVie, avec son approche CAR-T in vivo, est un signe fort… »
Je ne vois pas le domaine en termes de concurrence frontale, mais plutôt comme un champ en construction, où il y a de la place pour plusieurs modèles. Le rachat de Capstan par AbbVie, avec son approche CAR-T in vivo, est un signe fort : on passe de plateformes coûteuses à des solutions plus industrialisables.
Cela ouvre la voie à une démocratisation de la thérapie génique, avec des traitements potentiellement curatifs, compatibles avec une production à large échelle. Chez EG 427, c’est exactement notre ambition : faire de la thérapie ADN un traitement accessible, standardisé, et économiquement viable pour les systèmes de santé.
Notre technologie repose sur des bases solides : le HSV est bien connu, peu immunogène et ré-administrable. Notre ambition est de rendre ces innovations accessibles au plus grand nombre, et en particulier dans le traitement de maladies chroniques à forte prévalence.
Samuel Salot, EG427, interviewé par l'équipe MabDesign - en Juillet 2025
Depuis la réalisation de cette interview, EG427 a publié deux communiqués de presse annonçant des résultats cliniques ainsi que l’obtention de la désignation Fast Track par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Leurs communiqués sont disponible ici :
Vous souhaitez en savoir plus ?
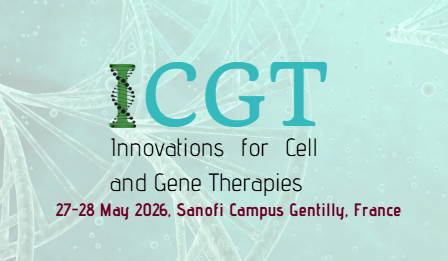
Ne ratez pas le congrès Innovations for Cell and Gene Therapies « ICGT » organisé par MabDesign, qui aura lieu les 27 et 28 May 2026 au Sanofi Campus Gentilly.
Pour plus d’informations Cliquez ici ou nous contacter pour plus d’informations !
MabDesign a acquis et cultive son expertise sur tous les sujets associés aux biomédicaments et à la bioproduction. Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans tout vos projets liés au secteur des biothérapies, et notamment des thérapies cellulaires. N’hésitez pas à explorer notre offre de services, nos formations, et nos évènements si vous souhaitez en savoir plus !